Il faut bien le reconnaître, un des aspects les plus fascinants quand on écrit des livres est d’assister à cette interminable, chaotique, et parfois douloureuse, mutation d’une idée volatile en une masse de papier et de carton d’environ 200 grammes pour un poche, 600 pour un album grand format.

Du lézard à la chimère
Au début, c’est un lézard squelettique et immobile qui prend le soleil aux abords d’une anfractuosité de ton cerveau. Un mouvement trop brusque et l’animal disparaît dans les obscurités de ton cortex préfrontal pour ne jamais en ressortir. À la fin, la chose se présente sous la forme d’un parallélépipède plus ou moins épais (jusqu’au pavé indigeste) qui possède le caractère pratique de se ranger aisément sur une étagère. Mais ce n’est pas son unique qualité, car – Ô magie ! – si un autre que toi vient à l’ouvrir, il y retrouvera le lézard métamorphosé par tes soins (et ceux de l’illustrateur, de l’éditeur, du maquettiste, du photograveur, de l’imprimeur…) en une chimère aimable et accessible, un enchantement de personnages, d’actions et d’émotions qui vivront dans son esprit comme ils ont vécu dans le tien. De la télépathie en quelque sorte.
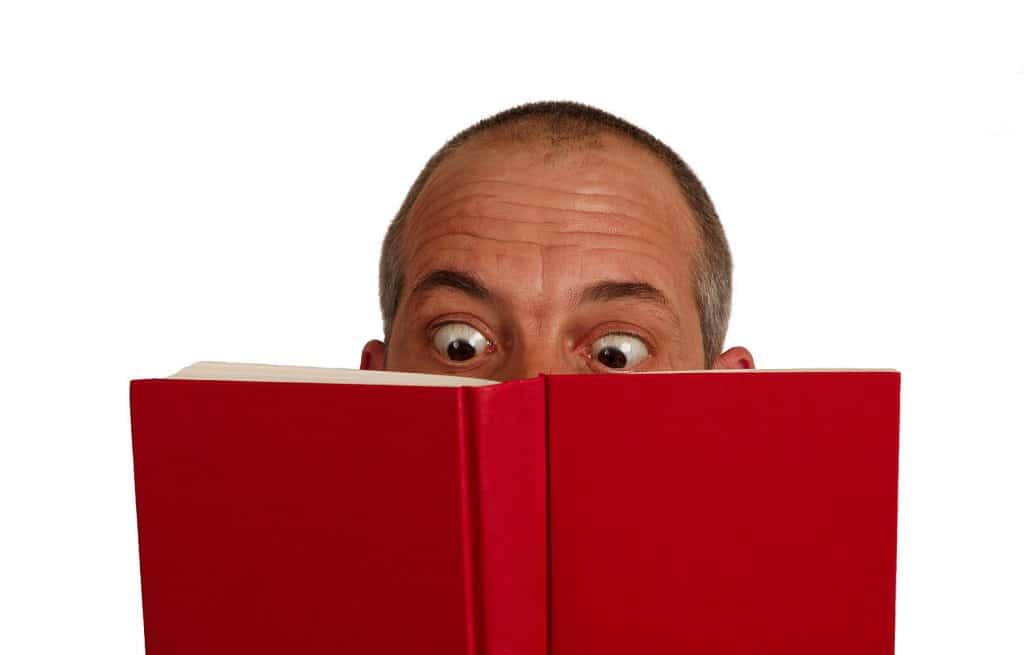
Le boulot de l’auteur
Le germe, l’idée, l’image séminale qui préside à l’ensemble paraissent souvent prosaïques et parfois très éloignés du résultat final. Umberto Eco raconte que sa première vision du Nom de la Rose fut celle d’un moine s’humectant les doigts pour tourner les pages d’un lourd volume. Ici, point de meurtre, d’enquête policière, de Guillaume de Baskerville ou de Rose farouche s’amourachant d’un moinillon dans les cuisines de l’abbaye.
Une fois cette idée survenue, identifiée, et déterminée comme assez puissante pour justifier le long travail à suivre, les choses sérieuses commencent. Surtout, ne pas se caler devant son écran pour se lancer tête baissée dans la rédaction ! Grave erreur que commettent souvent les novices enthousiastes. Non, il faut d’abord élaborer, concocter, intriguer, imaginer des ingrédients imprévus. Un roman ne revient pas à saisir un morceau de bidoche (même s’il existe des exemples), mais le plus souvent à mitonner un ragoût qu’il est bon d’oublier sur le feu à l’occasion.
Ensuite, une fois ta tambouille au point, reste à bien la présenter dans l’assiette, donc à en rédiger une version littéraire avec des mots qui se suivent jusqu’à faire des phrases, des paragraphes, des chapitres et tutti quanti. Il est possible d’y mettre beaucoup d’art et de patience (on appelle ça faire du style), il est aussi possible d’opter pour un cornet en papier et une grosse dose de mayonnaise (on dit alors pudiquement que l’auteur s’efface devant son histoire). Quoi qu’il en soit, la partie n’est pas terminée. Enfile ton costume et fais ton entrée en salle !
Contrairement au restaurant, ici, les clients (aussi appelé éditeurs) ne commandent pas toujours leur menu à la carte. Il te faut circuler au milieu des tables, croisant de multiples confrères eux aussi en toque et tablier blanc. Chacun évolue, avec un air de décontraction qui ne trompe personne, son plateau fumant à la main en espérant qu’une table, suffisamment alléchée par le frichti, en vienne à vouloir mirer le plat de plus près. Peut-être sera-t-il au goût de ces messieurs (et dames, nombreuses dans l’édition), certainement te demanderont-ils d’ajouter un peu de sel ou de poivre, de ceci ou de cela (ou même de te séparer de cette pomme de terre – un personnage, une scène, un chapitre – que tu as cuisinée avec amour, mais jugée inutile dans l’assiette). Voilà, tu vas être publié.
Nous n’en sommes qu’à la moitié
Il n’est pas rare qu’une année ou plus s’écoule entre le moment où un manuscrit est accepté et le jour glorieux où ton ouvrage ira rejoindre les étalages des libraires (à peine moins que le temps qu’il mettra parfois à succomber sous les coups du pilon des invendus). Dans ce laps de temps, beaucoup de personnes vont se pencher sur le berceau de ton bébé, autant de fées dispensant leurs dons. L’éditeur d’abord, qui contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n’est pas un sinistre personnage tout juste bon à se faire du beurre sur ton Grand Œuvre (quand il ne s’avise pas de le passer sous les bistouris esthétiques de l’air du temps pour le changer en un vulgaire roman de plage putassier). L’image est fausse. Un éditeur est avant tout ton premier lecteur, il défend la plupart du temps avec conviction ton travail (il existe des contre-exemples) et s’il demande des modifications ce n’est jamais sans raison. Il concourt à l’amélioration de la qualité de ton livre, et souvent y parvient. Ceux qui prédisent la fin de l’éditeur traditionnel grâce au développement de l’autoédition nous promettent un monde où l’immense majorité des romans seront moins aboutis, moins fouillés et donc moins bons. Au passage, je ne voudrais pas laisser croire que les maisons d’éditions font toutes office de bonnes œuvres pour écrivains en mal de publication. La rémunération est parfois l’objet d’âpres conflits dont l’auteur sort rarement vainqueur.
Vient ensuite, dans le cas particulier de la jeunesse, l’illustrateur. Collaboration le plus souvent heureuse et chaleureuse entre soutiers du livre pour enfants. Ici, la modestie est de mise, comme la passion et la persévérance. La reconnaissance et les revenus sont faibles, l’avenir parfois incertain et, quoi qu’il en soit, laborieux. Avouons que ça pousse à la camaraderie.
Puis viennent les petites mains (tout aussi indispensables que dans la haute couture) : graphiste, maquettiste, photograveur qui travaillent à la conception de l’objet, l’imprimeur qui le fabrique. Puis les autres, encore plus anonymes (en tout cas depuis l’isolement de ton bureau), le diffuseur, les commerciaux… et jusqu’au type qui va transporter ton bouquin ! Haleine parfumée au café, il fait signer son reçu avec un geste d’impatience – il n’a pas que ça à faire – après avoir déposé un tas de cartons dont il se fiche bien de savoir qu’ils contiennent quelques exemplaires de ton précieux travail. Machinerie obscure qui a pour résultat qu’un jour tu reçois un SMS de ta tante ou d’un ami d’enfance avec photo mal cadrée d’un rayonnage où trônent tes opus : « En vacances dans le Jura, devine sur quoi je tombe ! »
La chaîne se poursuit : les libraires (incontournables, il faudra en reparler), les maîtres d’école, les bibliothécaires, et jusqu’aux lecteurs ! « Tu devrais lire ça, c’est vachement bien ». En fait, si c’est beaucoup ton bouquin, c’est aussi un peu le livre de plein de gens. Et c’est très bien ainsi…
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer


